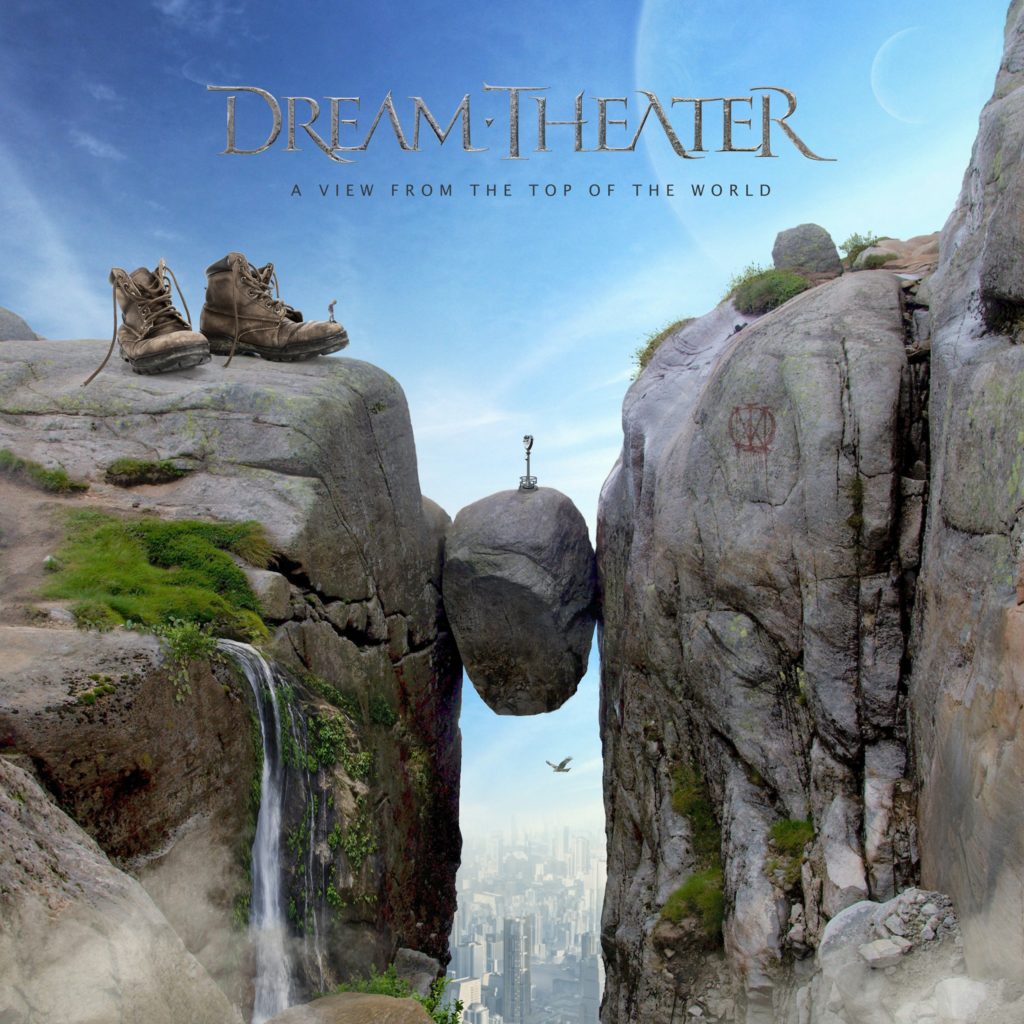Il est temps d’élire l’album de l’année 2024. L’an passé je me suis bien fait allumer avec ma sélection, faut dire que j’avais osé la pop et snobé les grandes sorties du prog.
Cette année, je ne suis pas certain que mon choix va faire l’unanimité non plus. L’album de l’année fait partie des rares vinyles que j’ai achetés en 2024 ce qui limite drastiquement le nombre de candidats.
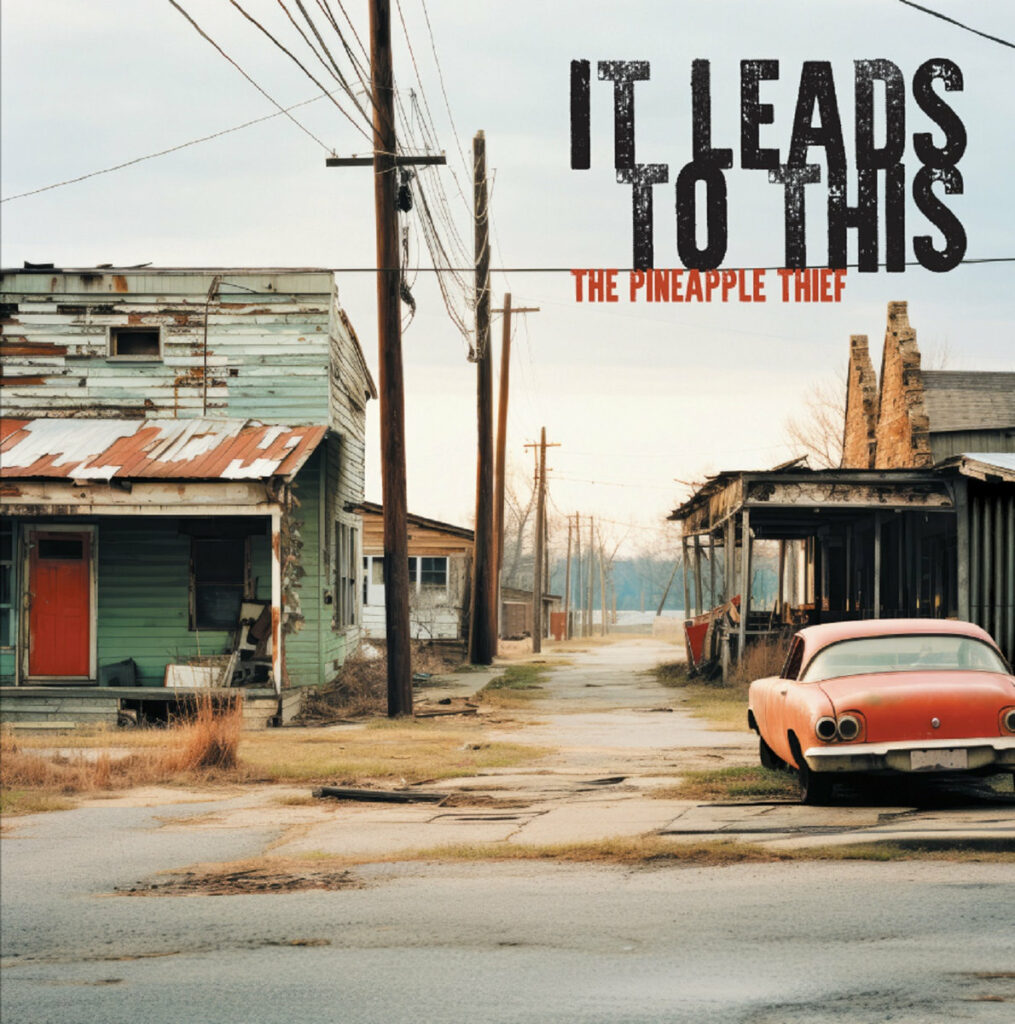
Il y a tout d’abord The Pineapple Thief avec l’album It Leads To This sorti en début d’année que j’ai téléchargé sur Bandcamp et finalement commandé en vinyle quelques mois plus tard. Un album que je trouve plus proche du travail de Bruce Soord en solo que des productions habituelles de The Pineapple Thief sorti de Magnolia.
Je suis tout de suite tombé amoureux de son atmosphère feutrée, de sa sensibilité à fleur de peau, de son format court que j’apprécie de plus en plus et de sa magnifique pochette représentant une Amérique déchue.
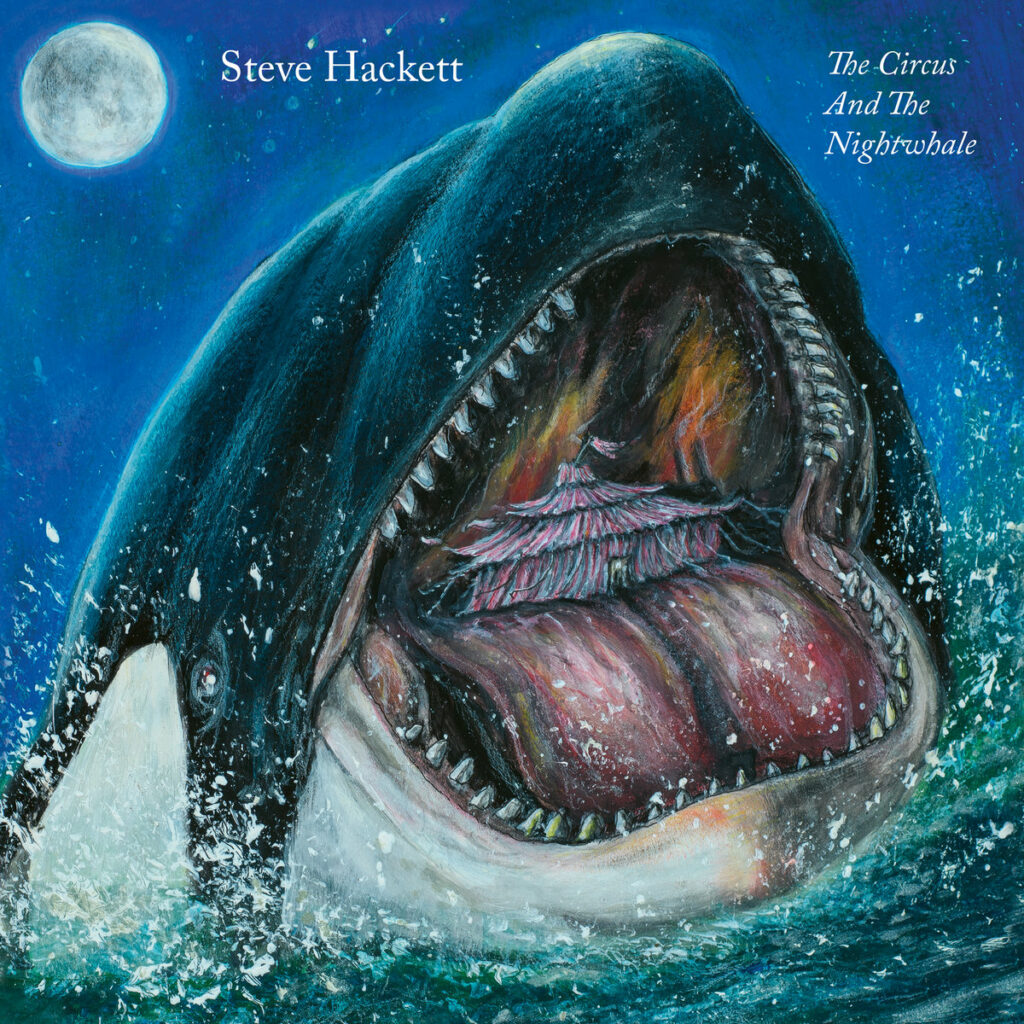
Le second vinyle que j’ai acheté est celui de Steve Hackett avec son magistral concept album The Circus and the Nightwhale. Le premier concept album de Mr. Hackett tout de même où il se raconte, lui et sa musique.

Évidemment il y a FROST* avec Life in the Wires, un autre concept album au passage.
Je ne suis pas toujours en phase avec le groupe britannique surtout quand la galette dure plus d’une heure et demie mais j’avoue que Life in the Wires m’a tout simplement ébloui. J’y reviens très souvent, enfin lorsque j’ai assez de temps pour lui consacrer une écoute complète. C’est certainement aujourd’hui mon album de FROST* préféré.

Et puis il y a Nightwish avec Yesterwynde. Oui je sais, c’est Nightwish et l’an passé j’avais failli faire grimper sur le podium le premier album solo de Floor Jansen. Encore une fois j’assume. Leur pop metal symphonico cinématique me transporte à chaque écoute et la voix de Floor est magique.

J’ajouterai bien à cette petite sélection un compact disk que j’ai beaucoup aimé. J’avoue que j’ai acheté encore moins de CDs que de vinyles cette année. Ce disque, c’est celui de Oceans of Slumber, Where Gods Fear To Speak. Ce n’est pas un secret, j’aime beaucoup Oceans of Slumber et cet album, peut être est-ce l’effet de la nouveauté, est un de mes préférés.
Ces cinq albums m’ont particulièrement impressionnés et je reviens dessus régulièrement entre deux chroniques.
Mais si j’en crois le nombre de vues sur Youtube, ce serait Nightwish qui remporterait le titre d’album de l’année avec 262 vues. Oui je sais, ce n’est pas grand chose mais bon pour ma chaîne c’est un très bon score. Leprous arriverait en seconde position et Marco Gluhmann en troisième.
Mais je n’ai pas suivi l’avis du public comme souvent. Je crois que les deux albums que j’ai le plus écoutés cette année sont Where Gods Fear To Speak et It Leads To This. L’un des deux est mon vainqueur 2024.
D’un côté du métal progressif à la voix de gospel et growl, de l’autre du rock alternatif tout en douceur.
Les prog heads auraient sans doute voté pour Steve Hackett ou FROST*, les métalleux pour aucun de ces albums, la ménagère aux piercings pour Nightwish, mais moi je vote pour The Pineapple Thief qui monte sur la première place du podium.
Mes arguments pour défendre cet album sont purement subjectifs. Je reviens vers It Lead To This lorsque j’ai besoin d’un havre de paix musical, d’intimité, de douceur, de beauté et d’une musique tout en finesse. J’aime beaucoup le travail de Bruce Soord en solo et It Leads To This s’en rapproche même si The Pineapple Thief ressurgit de temps en temps. Je suis également un grand admirateur de Gavin Harrison et c’est aujourd’hui dans ce groupe et non Porcupine Tree que j’apprécie le plus son travail.
J’ai beaucoup aimé également Insanium de Whom Gods Destroy, The Like Of Us de Big Big Train et plein d’autres albums, mais It Lead To This s’est tout de suite détaché des autres et dès sa sortie j’ai compris que ce serait mon album 2024. Si vous ne l’avez pas encore écouté, foncez le découvrir, c’est une merveille.
Je ne vous demande pas d’être d’accord avec moi. Ce n’est que mon avis et je le partage. L’an passé mon album de l’année a bien énervé certains comme quoi c’est toujours compliqué la liberté d’expression de nos jours.